Contenu de la page.
Récits de L’Hôtel-Dieu de Québec
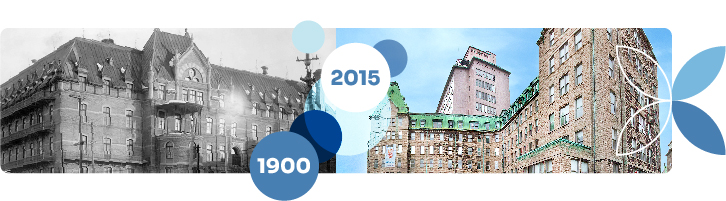
L’Hôtel-Dieu de Québec
Marie-Madeleine de Vignerot, nièce du cardinal de Richelieu, devient duchesse d’Aiguillon en 1638. Elle décide de fournir les fonds nécessaires à l’établissement d’une institution de soins et d’évangélisation pour les autochtones en Nouvelle-France et, le 16 août 1637, elle signe avec les Augustines de L’Hôtel-Dieu de Dieppe un contrat les engageant à réaliser cette mission.
La construction de l’hôpital, que l’on nomme alors « Hôtel-Dieu du Précieux-Sang », débute à l’emplacement actuel dès 1638. Cependant, les fondatrices Marie Guenet de Saint-Ignace, Marie Forestier de Saint-Bonaventure et Anne Le Cointre de Saint-Bernard n’accosteront dans leur nouveau pays que le 1er août 1639.
Lire la suite »
À leur arrivée, elles font arrêter les travaux, jugeant le terrain à flanc de rocher peu accessible et peu propice à l’érection de leur hôpital. Elles préfèrent s’établir à la mission de Sillery où elles se trouvent plus près des communautés montagnaises et algonquines, leurs bénéficiaires cibles. Elles y resteront de 1640 à 1644, mais devront quitter l’emplacement en raison d’un conflit qui éclate avec la communauté iroquoise.
Les fondatrices redémarrent alors la construction de L’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang sur le site initial, ce qui en fera le premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique. Cet établissement sera notamment soutenu par l’administration de Jean Talon, premier intendant de la Nouvelle-France, qui encourage les soins de qualité que prodiguent les Augustines.
L’hôpital gagnera en renommée lorsque s’y succéderont la religieuse Marie-Catherine de Saint-Augustin          ainsi que le médecin Michel Sarrazin          . La première consacrera vingt ans de sa vie à l’institution; elle deviendra d’ailleurs célèbre en raison de son dévouement envers l’hôpital, la Nouvelle-France et l’Église canadienne. Le second créera sa renommée grâce à ses talents de guérisseur et de chirurgien dont il usera à maintes reprises lors de traitements parfois très innovants pour l’époque. En effet, L’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang deviendra le premier hôpital au Canada à faire usage de la chirurgie pour lutter contre le cancer.
Les années 1750 s’avèrent difficiles pour l’hôpital et son personnel. Le 7 juin 1755, deux matelots, patients de l’établissement, déclenchent un incendie par rancune à l’égard de la mère Hospitalière. Le feu ravage une grande partie de l’édifice et se propage même au voisinage. La reconstruction s’étalera de 1756 à 1757, ce qui rendra l’hôpital peu accessible pendant cette période.
En 1759, l’hôpital est assiégé par l’armée anglaise après la capitulation de Québec. Malgré les bons liens que cultive le Général Murray avec les Hospitalières, elles auront un accès très restreint à leur hôpital. Comme les Anglais utilisent l’enceinte de l’établissement pour leurs soldats, L’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang est pratiquement fermé à la population, sauf pour certains cas majeurs. Pour continuer à subvenir à leurs besoins, les religieuses procèdent à toutes sortes de travaux d’artisanat et à d’autres petites tâches.
Vers 1775, pendant la Révolution américaine, la ville et son hôpital seront une fois de plus assiégés par les Américains. Enfin, en 1784, l’armée anglaise quitte les lieux et les religieuses retrouvent l’accès entier à leur hôpital.
De 1801 à 1850, à la demande du gouvernement, l’hôpital se transforme en orphelinat « des Enfants trouvés ». Lorsque l’établissement revient à sa mission d’origine, il aura accueilli près de 1 375 enfants orphelins.
En 1855, l’hôpital prend une vocation universitaire; on y soigne alors les personnes âgées, celles souffrant de maladies mentales, les épileptiques, les alcooliques et les cancéreux. C’est à cette époque que le docteur Michael Joseph Ahern         œuvre à L’Hôtel-Dieu. Figure marquante de l’histoire de l’établissement et dans la vie des jeunes médecins d’alors, le Dr Ahern         pose les théories pasteuriennes au cœur de sa pratique et de ses enseignements. C’est ainsi qu’il instaure la stérilisation et la désinfection du matériel médical et qu’il fait aménager des espaces réservés aux chirurgies afin de limiter les risques d’infections et de contagion. Grâce à lui, les chirurgiens procéderont aux opérations dans un endroit prévu à cet effet plutôt que directement dans le lit du patient.
L’ouverture du pavillon d’Aiguillon, en 1892, permettra l’ajout de 100 lits dans l’hôpital. C’est ce même pavillon qui se transformera plus tard en fameuse tour rose de 14 étages qui occupe encore aujourd’hui la partie centrale du bâtiment. La capacité de l’hôpital atteindra 231 lits en 1907.
Si L’Hôtel-Dieu de Québec assume le fonctionnement du centre anticancéreux dès les années 1930, le Centre de l’ouïe et de la parole ainsi que le Centre de recherche sur le cancer sont respectivement fondés en 1960 et en 1983. Ces deux entités participent au développement de la spécialisation et de la surspécialisation de l’institution en ce qui a trait aux recherches et aux traitements contre le cancer ainsi que dans le domaine des troubles de l’ouïe, de la parole et de la voix.
Aujourd’hui, L’Hôtel-Dieu de Québec offre des soins spécialisés et surspécialisés particulièrement en cancérologie et en néphrologie, ainsi que des soins d’urgence. Les activités de recherche fondamentale, clinique et évaluative du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval situées à L’Hôtel-Dieu de Québec sont axées sur l’oncologie, la thérapie génique et la néphrologie.
Photo : 03Q_P560_S1_P000808_LHDQ
Hôpital Hôtel-Dieu - Pavillon d'Aiguillon, [vers 1900], BAnQ Québec, Fonds J. E. Livernois Ltée, (03Q,P560,S1,P808), Photographe non identifié, https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3113522         .
Sources
Les Augustines. Les Augustines : Filles de la Miséricorde, Québec, 15 p.
Les Augustines. Les Augustines : Monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec, Québec, 1984, 31 p. (format dans une pochette).
Collectif. « L’Hôtel-Dieu de Québec : 350 ans de soins hospitaliers », Cap-aux-Diamants, numéro hors-série (1989), 90 p.
 Le résumé de ce récit fait partie de la murale Nos origines qui est exposée dans le corridor menant à la clinique externe de L’Hôtel-Dieu de Québec.
Le résumé de ce récit fait partie de la murale Nos origines qui est exposée dans le corridor menant à la clinique externe de L’Hôtel-Dieu de Québec.

La pharmacopée au temps des Augustines
La médecine au Canada débute bien avant l’arrivée des premiers colons sur le territoire. Les Premières Nations utilisaient déjà la faune et la flore afin de se soigner et, à l’arrivée des Européens, ils leur transmettent généreusement une partie de leur savoir. On dit d’ailleurs que Jacques Cartier aurait fait appel aux connaissances des autochtones pour guérir les membres de son équipage malades du scorbut, ce qui fût fait grâce à une décoction d’aiguilles et d’écorce d’épinette blanche.
Pour soulager ou guérir les maux les plus courants, les autochtones avaient aussi recours à l’essence de wintergreen*, au sang-dragon et au pimbina, qui était fournis par le chaman ou le guérisseur. D’autres traitements, comme les sueries et les massages, étaient aussi très populaires.
Aux 17e et 18e siècles, les Européens et les habitants de la Nouvelle-France font surtout appel à des chirurgiens-barbiers, au savoir rudimentaire, ou à des apothicaires, avec des formations approximatives, en matière de soins et de remèdes. Parmi les pratiques courantes, on retient surtout les lavements, la sudation, la diète, la saignée, les vomissements, la purge ainsi que les chirurgies aux bras, jambes, à la tête ou sur d’autres surfaces du corps. Les chirurgiens-barbiers pratiquent aussi des opérations internes, mais elles mènent souvent à la mort du patient…
Agissant à titre d’apothicaire et parfois même de chirurgienne à L’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang (devenu depuis L’Hôtel-Dieu de Québec) vers la fin du 18e siècle et au début du 19e, sœur Marie-Angélique Viger de Saint-Martin est réputée pour sa maîtrise des secrets de l’« apothicairerie ». Elle utilisait par exemple la thériaque, un tonique et remontant cardiaque créé avec de l’alcool, de l’opium, de la vipère séchée en poudre et une cinquantaine d’autres produits. Le rognon de castor faisait des miracles pour la goutte, l’épilepsie, le mal de tête, le mal de dents, la surdité, l’insomnie et la folie. Un pied d’orignal pouvait aussi soigner l’épilepsie, tandis que le lait d’ânesse aidait à contrer les maladies pulmonaires. Selon des rapports de l’époque, des malades provenant d’aussi loin qu’Halifax faisaient la route jusqu’à Québec pour recevoir ses bons soins et conseils qui semblaient bénis par Dieu.
Mais LE remède qui fait sensation à l’époque est « l’onguent divin ». Recommandé par tous, il permet de guérir un fou de sa folie, de refermer les plaies d’un homme et de prévenir l’amputation de sa main, de sauver de la gangrène en seulement 24 heures, d’assurer la régénération rapide des tissus, de nettoyer, d’aseptiser et de faire sortir les corps étrangers des plaies, d’arrêter le sang d’une coupure et de soigner les brûlures, en plus de guérir des maux aux yeux, des hémorroïdes et des blessures venimeuses.

« Recette de l’onguent dit "onguent divin" que l’on peut appliquer sur les plaies pour éviter que les linges s’attachent sur les plaies ouvertes. Prenez une livre de mine de plomb rouge (minium) en poudre très fine, deux litres d’huile d’olive fine et six onces de cire jaune. Faites cuire le tout dans une casserole de terre neuve vernissée, en remuant sans cesse avec une spatule en bois jusqu’à ce que cela commence à brunir. Étendre légèrement l’onguent sur du petit cuir noir et appliquer sur la plaie, afin que le linge ne s’y colle pas. »

Pour leurs remèdes, les Augustines de L’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang s’approvisionnent souvent en France, auprès l’apothicaire Jacques-Tranquillain Fréret de Dieppe – c’est également lui qui leur fournit la recette de l’onguent divin – ainsi qu’auprès de ses confrères aussi bien en France qu’en Nouvelle-France. À l’époque, les monastères possèdent presque tous leur jardin de plantes médicinales et les Augustines ne font pas exception. Elles en prennent bien soin, d’autant plus que c’est une ressource qui leur permet d’alléger les dépenses liées aux médicaments, car l’institution s’endette auprès des apothicaires.

Les Augustines n’ont pas fait de grandes découvertes en matière de traitements pharmaceutiques, mais elles ont établi un mode de gestion assez moderne, en s’assurant notamment de contrôler toutes les étapes des traitements, de la culture des plantes médicinales aux soins au chevet, en passant par la fabrication des médicaments.
* Essence de wintergreen : « Huile essentielle, extraite des feuilles de gaulthérie ou de l'écorce de bouleau, employée en parfumerie. », https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17571648/essence-de-wintergreen

Un résumé de ce récit est exposé devant les ascenseurs situés près de la cafétéria de L’Hôtel-Dieu de Québec.

Photo « Sœur Saint-Léandre en préparation de médicaments », [1928 ou 1942?] – Québec, Le Monastère des Augustines, HDQ-F5-I1,3/22:2.

Sources
Barbeau, Gilles. Curieuses histoires d’apothicaires, Québec, Septentrion, 2018, 210 p.
Casgrain, L’abbé H. R. Histoire de L'Hôtel-Dieu de Québec, Québec, Léger Brousseau, 1878, pp. 478-612.
Charas, Moyse. Pharmacopée royale galénique et chymique, Paris, Laurent d’Houry, 1691, 949 p.
Roland, Charles G. « Histoire de la médecine jusqu’à 1950 », dans Eli Yarhi, dir., L’encyclopédie canadienne, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-de-la-medecine-jusqua-1950 (page consultée le 27 mars 2023).

L’implant cochléaire
On croit que la simulation électrique d’organes humains est une technique contemporaine, mais ce n’est pas le cas. En fait, autour de l’an 0, des médecins de la Rome antique utilisaient déjà des raies électriques pour traiter des maux de tête, mais il faut attendre les années 1790 pour que la première « expérience de stimulation électrique de l’oreille interne » ait lieu.
Au Québec, c’est en 1960 que le Dr Paul Fugère fonde le Centre de l’ouïe et de la parole à L’Hôtel-Dieu de Québec et qu’il « développe la chirurgie microscopique pour le traitement de la surdité ». En France, à la même époque, des médecins développent l’implant cochléaire, qui permet de stimuler le nerf auditif à l’aide d’un appareil greffé dans l’oreille interne, et de grandes avancées sont réalisées. Le Dr Pierre Ferron, œuvrant au Centre de l’ouïe et de la parole, suit une formation sur le sujet à Paris et, de retour à Québec, il crée en 1979 un programme de recherche sur les implants cochléaires.
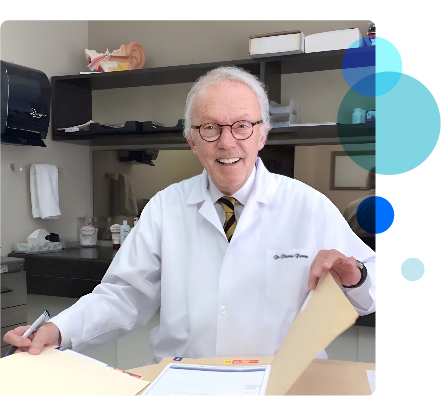
Dr Pierre Ferron

Le 20 octobre 1983, le Programme québécois d’implant cochléaire est créé à L’Hôtel-Dieu de Québec et, en mai 1984, le Dr Ferron réussit la pose du premier implant cochléaire multiélectrode au Canada après une chirurgie de six heures.

Fait notable : c'est la congrégation des Augustines qui a défrayé les coûts du premier implant cochléaire.
Depuis cette première chirurgie, près de 4 000 personnes ont pu elles aussi bénéficier de cette avancée grâce à l’équipe du Centre québécois d’expertise en implant cochléaire. Ainsi, chaque année, ce sont environ 200 interventions qui sont réalisées chez des patients de tout âge, de quatre mois à 91 ans!

Un résumé de ce récit est exposé dans la salle d’attente 1536 du secteur de l’ORL de L’Hôtel-Dieu de Québec.

Photo Dr Pierre Ferron – Collection personnelle.

Sources
Bergeron, François. « Petite histoire de l’implant cochléaire », dans Audition Québec, https://auditionquebec.org/wp-content/uploads/2021/03/Petite-histoire-de-limplant-cochleaire.pdf (page consultée le 28 février 2023).
Bouchard, Christian. « Exceller et rayonner », Cap-aux-Diamants, numéro hors-série (1989), pp. 87-90.
Corneau, Maxime. « Percée médicale pour faciliter la vie de centaines de malentendants », 27 février 2019, dans Ici.Radio-Canada, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154612/implants-cochleaires-chu-quebec-innovation-sante (page consultée le 28 février 2023).
|